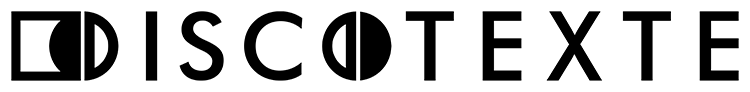Les plaisirs
de Sébastien
![]()
Sébastien Tellier « Sexuality »
L’héritier légitime d’un musicien de l’inclassable groupe Magma n’est pas frustré. Au contraire : comparés aux génies libérés d’Erik Satie, Frank Zappa, Robert Wyatt (Soft Machine) ou Syd Barrett (Pink Floyd), l’esprit et le talent du fantasque Sébastien Tellier ne cessent de s’épanouir. Après avoir dénudé ses meilleures compositions dans sa compilation acoustique Sessions (Record Makers, 2006), l’artiste exhibe ses nouvelles préférences électroniques pour Sexuality, son troisième album studio.
Rendez-vous avec Sébastien, transpercé par les flèches de l’amour, pénétré par des flashs didactiques, stylistiques et érotiques.



I. (R)ÉVOLUTION
Discotexte : Après L’Incroyable vérité (Record Makers, 2001) et Politics (Record Makers, 2004), Sexuality est à nouveau un album-concept, avec une identité sonore et thématique encore différente. Avez-vous l’intention de rester insaisissable ?
Sébastien Tellier : Oui, d’une certaine manière… La perfection peut se trouver soit dans le monde de l’équilibre, lorsque deux notions opposées coexistent – par exemple, superficiel/profond – et dans le vide absolu, là où il ne peut pas y avoir d’imperfection. Changer tout le temps, ça signifie que je ne suis ni comme j’étais avant ni comme je serai plus tard : je suis parfait parce que je ne suis rien du tout. Ce qui est important, c’est de ne pas refaire un disque tant qu’on n’a pas changé d’état d’esprit. Refaire le même type de compositions, des redites, les mêmes accords mais pas dans le même ordre ? Ça ne m’intéresse pas du tout ! C’est bien plus passionnant de se pointer en studio, derrière un piano, et de se mettre à jouer ; d’aller découvrir ce qu’on pourrait faire qu’on n’a jamais fait. Sinon pourquoi faire de la musique ? Sexuality n’aurait eu aucun intérêt si mes goûts, si ma vision du monde, n’avaient pas changé. Je vis plusieurs vies à travers mes albums, et c’est ce qui me plaît : l’aventure intellectuelle et artistique totale, intense. C’est-à-dire me renouveler, moi, pour créer un nouvel art – puisque je suis le carburant de mon art, c’est à moi de changer, de me régénérer. Et, de disque en disque, je change d’appartement, de voiture, de garde-robe… Avant Sexuality, j’ai aussi changé de petite amie – je ne l’ai pas voulu, c’est comme ça – et j’ai découvert l’amour, ce qui m’a libéré et apporté tout un tas de choses… Tous ces changements, c’est ce qui crée l’intensité de mon art. L’art va au-delà de mon disque : il est aussi dans ma vie. Et c’est toute ma vie qui est tournée vers mon art.
Est-ce une forme d’autodestruction pour mieux recréer ensuite ?
Oui, voilà. Je n’aime pas les gens bourrés de certitudes, ceux qui se comportent comme si le chemin était fini. Je suis tellement opposé à cette vision-là du monde, de sa propre vie, que je fais complètement l’inverse, par réaction. On ne devrait pas pouvoir se complaire dans l’art, qui est de l’ordre de l’instinct, du destin, du hasard, et certainement pas du « ça je sais le faire, alors je vais le refaire » ! À part si c’est poussé à l’extrême, comme avec AC/DC : c’est tellement tout le temps pareil que ça en devient vraiment artistique, il y a une vraie logique. Par contre, sans citer personne, beaucoup de chanteurs de variété française font toujours le même disque, ne parviennent pas à se renouveler. Peut-être qu’ils n’en ont pas l’envie. Et ça, pour moi, c’est terne, c’est triste : c’est une vie ratée. J’admire les Beatles, qui ont fait des disques très différents les uns des autres : on sent vraiment une évolution entre chacun ; ce ne sont pas les mêmes mecs, et ça se sent vraiment. Pink Floyd, aussi : la différence entre Wish You Were Here (EMI, 1975) et Animals (EMI, 1977), Animals et The Wall (EMI, 1979)… Il y a d’autres groupes que j’adore et qui ne font pas systématiquement le grand nettoyage entre tous les albums : les Beach Boys, par exemple. Mais, encore une fois, ce n’est pas ce que j’aimerais vivre… Et puisqu’il est impossible de se changer totalement – même avec la meilleure volonté du monde, il y a toujours quelque chose qui reste – on ne peut pas se perdre en faisant table rase. À défaut de pouvoir subir un lavage de cerveau, je suis bien obligé de me contenter de changer ce que je peux changer !
Mais comment fidéliser un public, alors ?
Je ne fidélise personne, effectivement. Et quand je vais lire, de temps en temps, des critiques, bonnes ou mauvaises, sur MySpace, je m’aperçois que les anciens « fans » sont déstabilisés… Pourtant, j’aimerais bien faire partie de la variété française, mais en faisant quelque chose de complètement différent. Car ce n’est pas la dimension commerciale de la variété qui me plaît, mais plutôt le fait d’appartenir à la culture générale des gens. Je suis mal à l’aise dans une niche underground, mal à l’aise dans la niche intello dans laquelle on m’a plongé : appartenir à la variété, c’est finalement fuir tout ça. Et ce n’est pas l’appât du gain : je vis aujourd’hui avec La Ritournelle, et Fantino aussi, dont s’est servi Sofia Coppola [sur la bande originale de son film Lost in Translation (American Zoetrope / Elemental Films / Pathé, 2003) ndlr]. Ce sont pourtant des chansons hors format ! Je n’ai donc pas besoin de me « prostituer » parce que j’ai de la chance, tout simplement. Parce qu’avec de l’art pur, j’arrive à vivre quand même… Ça s’est juste bien passé, on ne sait pas pourquoi, c’est comme ça. Donc, quand je parle de variété, je parle d’une façon de toucher les gens, de faire des émules, d’avoir une influence sur la culture générale des gens. Comme l’ont fait avant moi des gens que j’admire : Daft Punk, qui a complètement renouvelé la vision de la musique festive (au-delà de la dance en général), et Air, qui a complètement renouvelé la production musicale à la sortie de leurs premiers albums. Ils ont eu un impact certain sur le monde. Et moi, parce que j’ai toujours été catalogué « musique underground », « trop intellectuelle », je n’ai pas pu « changer le cours du monde », d’une certaine façon. Et ça me manque beaucoup.
II. RENCONTRES
Comment avez-vous rencontré ces deux duos de la musique électronique, Air et Daft Punk ?
J’ai signé mon premier contrat avec Record Makers, un label créé par Air. On n’a jamais fait de musique ensemble en studio, mais ils ont toujours fait partie de mon monde artistique. J’ai fait leur première partie [sur la tournée 10 000 Hz Legend, en 2001, ndlr] alors que je n’avais jamais donné de concerts avant – ou seulement deux, au Duc des Lombards, un club de jazz, avec ma guitare et ma voix. Et voilà qu’on m’envoie en répétitions à Houston pour un premier concert à Dallas ! J’ai commencé mes trucs à moi grâce à eux, dans des conditions de rêve. Ce qu’on met dix ou quinze ans à construire, moi, je l’ai eu tout de suite : trois semaines après avoir signé, j’étais parti sur les routes ! Quant aux Daft, je les ai toujours admirés – ils ont changé la face de la dance, quand même, c’est énorme ! Et comme avec Air, ça s’est un peu passé sans que je le décide. En fait, j’ai un rapport à la vie où je suis plutôt attentiste : je n’aurais jamais été déposé une maquette dans la boîte d’un des mecs de Air ou essayé d’écrire un mail bien senti à un des mecs de Daft Punk. Je ne fais pas ça : j’attends que les choses viennent à moi. Et Daft Punk, ils sont venus à moi en prenant une de mes chansons, Universe, pour la mettre dans Electroma [premier long métrage réalisé par Guy-Manuel de Homem-Christo et Thomas Bangalter, les membres de Daft Punk (Daft Arts, 2006), ndlr]. C’était un pas vers moi, et je me suis alors suffisamment senti en confiance pour demander à Guy-Man’ : « Est-ce que, éventuellement, tu voudrais bien passer à la maison écouter mes nouvelles démos ? »
La connexion semblait pourtant simple : après tout, Daft Punk s’est créé quand le guitariste de Darlin’, leur première formation, a rejoint le groupe Phœnix, dont les membres étaient alors les musiciens de Air lors de leurs prestations télévisuelles…
J’ai découvert tous ces gens-là en même temps, et que tous se connaissaient entre eux, quand j’ai signé mon premier contrat. Guy-Man’, je l’ai rencontré plus tard, en soirée : c’était la période où Daft Punk allait sortir Discovery (Virgin / EMI, 2001). Je me souviens : ils avaient fait une écoute au planétarium du Grand Palais, sur les Champs-Élysées, et j’étais très fier parce que j’étais assis à côté d’eux, et tout le monde venait me serrer la main comme si j’avais participé au truc, alors que je ne les connaissais pas ! Et puis j’ai recroisé Guy-Man’ dans des soirées – on a des amis en commun – ; et plus les années passaient, plus on était proches. Je dirais que toutes mes amitiés artistiques – dont Mr Oizo, Kavinsky et SebastiAn – sont basées sur le respect de l’art. Quand je fais de la musique, il y a un moment où l’esprit décroche de la réalité, et je vois alors le monde à travers la puissance émotionnelle des choses. Et je me rends compte que c’est pareil avec les gens : certains ont un effet sur moi, me donnent envie d’aller vers eux, ce sont ceux qui ont un énorme pouvoir émotionnel, c’est-à-dire des artistes qui me prouvent leur talent.


« Toutes mes amitiés artistiques sont basées sur le respect de l’art. Quand je fais de la musique, il y a un moment où l’esprit décroche de la réalité, et je vois alors le monde à travers la puissance émotionnelle des choses. C’est pareil avec les gens : ceux qui ont un énorme pouvoir émotionnel me donnent envie d’aller vers eux ; ce sont des artistes qui me prouvent leur talent. »

Alors, fatalité ou facilité ?
Ok, c’était aussi une solution de facilité. Quand je parle de sexe, je n’ai pas envie de faire quelque chose de difficile. J’ai envie que tout se passe bien comme j’ai envie de vivre une entente amoureuse parfaite. Donc il faut que tout se passe dans la facilité. C’est vrai que choisir Guy-Man’, pour moi, c’était très confortable. Travailler avec lui, c’était comme être dans une Rolls avec chauffeur : j’avais tout fait, moi, dans mon travail – tout écrit, tout composé –, et il a pris le truc en main, il s’est mis au volant et, depuis un grand canapé en cuir, je le regardais travailler en donnant quelques indications : « Plus comme-ci… Plus comme ça… »
Les séances n’étaient-elles pas intimidantes ?
Non, parce que, sous son casque, Guy-Man’ est quelqu’un de très mignon, de très gentil. C’est vraiment le type de personnage – on le dirait sorti d’un dessin animé ! –, un peu le genre de personne à qui on a envie de pincer la joue, quand on le voit. Et c’est quelqu’un qui essaie de donner du plaisir à ceux qui l’entourent – ce qui est très rare, dans le show-business ou même dans la vie. Il a su complètement s’oublier juste pour vivre avec les autres et leur faire du bien, finalement. Il a changé la vie de pleins de gens, la mienne aussi, et n’a jamais lâché personne. Donc, ça ne peut que bien se passer avec un mec comme lui : j’étais très à l’aise avec lui, parce qu’il dégage quelque chose de rassurant, de très apaisant. Et surtout, le plus important, cette notion que tout le monde oublie : la tendresse. Guy-Man’ est tendre, doux. C’est vraiment quelqu’un de bien…


III. SEXUALITY (OU LA MUSIQUE SEXUELLE)
On évoque la tendresse, les rapports humains. Justement, la pop électronique, les sons très synthétiques de Sexuality, sont-ils tout à fait en accord avec l’idée de l’affection, de l’amour, de la passion, et finalement du sexe ?
Ça m’a beaucoup apporté de faire un album sexuel. Le sexe, c’est quelque chose de très sophistiqué, qui va avec l’air du temps, avec la mode. Donc j’ai fait un album sexuel sophistiqué. Voilà. Ça ne va vraiment pas plus loin. Politics était un album sur la politique : ça dégueulait d’arrangements, il y en avait partout, il y en avait trop. Trop de fric, trop de m’as-tu-vu ; ça partait dans tous les sens parce que, comme en politique, exactement, j’essayais d’attraper n’importe qui, n’importe quel type de public : « T’aimes l’electro ? Il y aura de l’electro », « T’aimes l’acoustique ? Il y aura de l’acoustique », « T’aimes le piano ? Il y aura du piano »… L’Incroyable vérité parlait de mon enfance, de ma famille : je suis né en 1975, donc il est très seventies. Là, il se trouve que maintenant je n’avais pas envie, par exemple, de vivre un sexe des années 70 ni un sexe des années 50, mais plutôt de parle de sexe parce que c’est le sujet qui domine tout le reste, selon moi. Et parce que, finalement, on ne peut pas aller plus loin que de parler de l’origine de la vie. Je voulais plonger la sexualité dans la vision franche que j’ai du sexe, et qu’elle existe dans un équilibre parfait entre le superficiel – comme le monde du sexe et le sexe en général – et la profondeur – nécessaire, puisque le sexe, c’est aussi l’origine du monde, c’est tout simplement la vie. Et cet équilibre, je l’ai trouvé dans une musique toute synthétique, toute gentillette, efficace tout de suite qui me parlait aussi de la beauté de l’éphémère, pas d’intellectualisme.
Mais qu’est-ce qui vous a mené à l’electro ?
Je suis lassé des sons de contrebasse, de guitare et même de batterie acoustiques. Bon, j’écoute toujours Still & Nash, par exemple, mais ça ne me viendrait pas à l’esprit d’écouter un album de folk d’aujourd’hui. Ni du pop-rock ni du reggae. J’avais besoin de sonorités qui parlent de la chaleur de la nuit, une sorte de moiteur, et qui apportent un petit peu de nouveauté à mon oreille : et ça, je ne l’ai trouvé que dans l’électronique…
Pas même dans le R’n’B’ ? Certains titres sont pourtant très proches du genre…
C’est vrai, j’ai été très influencé par le R’n’B américain. En fait, c’est la seule musique qui évolue : il y a toujours de nouvelles rythmiques, de nouveaux sons… En musique, il y a un nombre limité de notes, et ce sont plus ou moins toujours les mêmes harmonies qui reviennent. On pourrait considérer que toutes les notes ont été exploitées avec les Beatles. Donc, maintenant, faire avancer la musique, ce n’est plus une question de notes mais de production. Il faut évidemment l’esprit d’un artiste qui a quelque chose à dire – un cerveau –, mais pour exprimer ensuite cette nouvelle vision du monde, on ne peut plus compter sur les notes : son expression ne se trouvera que dans la production puisqu’aujourd’hui seule la machine – l’ordinateur, les plug-ins, les synthés virtuels, etc. –, la technologie donc, évolue dans la musique. Cette culture-là, elle est digérée par le R’n’B bien plus que par les autres mouvements musicaux. Et c’est pour ça qu’il y a de la nouveauté dans le R’n’B – pour moi, ça s’est traduit par de nouveaux instruments, synthés entre les mains, de nouvelles table de mixage, équalisations… Voilà pourquoi j’ai envie d’appartenir à cette famille, à ces sons, à ces codes-là puisque je voulais, pour Sexuality, appartenir au monde de la sophistication, réussir à créer un album qui ait cette forme, cette espèce de jouissance directe. Que l’on puisse directement, sans en rendre les paroles, comprendre que c’est de la musique qui parle de sexe. Mais je voulais aussi que cet album ait l’esprit latin, l’esprit européen, l’esprit sexuel noble – avec ce rapport romantique au sexe qu’ont su conserver l’Italie et la France. En résumé, Sexuality est un album à la forme R’n’B et au cœur latin.

« Pour Sexuality, je voulais réussir à créer un album qui ait cette espèce de jouissance directe. Que l’on puisse directement comprendre que c’est de la musique qui parle de sexe. »


L’image et la personnalité du séducteur – que vous incarniez déjà avec votre reprise de La Dolce Vita, de Christophe – ne sont-elles pas contradictoires avec la provocation du titre de votre album, Sexuality ?
Christophe m’a influencé, pour Sexuality, c’est sûr. J’imagine le chanteur de ce disque comme un séducteur au cœur brisé. Et même si j’essaie de le vivre à travers le disque, ce n’est pas moi : je suis amoureux, très heureux en amour, et puisque j’ai une femme et que je ne veux qu’elle, ça n’a plus aucune importance de séduire les autres ! Je ne suis plus un séducteur ! Je suis très loin de ça ! Mais pour chanter un disque sexuel, comment se placer autrement qu’en séducteur au cœur brisé ? C’est ce qui avait le plus de charme, selon moi : je n’allais certainement pas me mettre dans la peau d’un professeur, froid, ni celle d’un queutard fini !
Même si aujourd’hui le sexe est omniprésent et ne choque plus grand-monde, cela reste-t-il difficile de présenter aux médias un album intitulé Sexuality, une musique que vous dites sexuelle et parfois illustrée de bruitages orgasmiques ?
Non, je suis très à l’aise, même en face de milieux auxquels je n’appartiens pas du tout. Parce que je ne parle pas de sexe en général, ni de prostitution ni d’affaires de justice : je parle de sexe au sein d’un couple amoureux, de l’amour, donc un sexe fondé sur la gentillesse, l’ouverture d’esprit, la tendresse et la douceur. J’ai un message positif, je crois, qui peut être – qui doit, même – être compris par tour le monde. Je ne cherche à choquer personne, et même avec une femme de 60 ans, je n’aurais aucune honte à discuter de ça.
En ce moment, vous êtes dans la plupart des magazines. D’autres vous ont-ils quand même censuré, juste en vous ignorant ?
Je ne pense pas. Parce que, précisément, les médias se régalent de sexualité. Plus le propos est sexuel, plus on en met. Je pense même que le fait que ce disque soit sexuel m’aide vraiment à le vendre, à répondre aux médias. Il y a toujours un petit « sexuality » qui traîne, parce que j’ai parlé de mon album : le titre est dans chaque paragraphe. Ni vu ni connu : on parle de culture, mais, en fait, on parle de sexe. Ce que je trouve affligeant, c’est la manière dont on en parle, souvent très, très mauvaise. C’est donc l’occasion pour les médias d’avoir quelqu’un qui apporte une parole nullement pornographique, sale ou malsaine, mais au contraire sincère, avec des valeurs de douceur.
Vous entamez désormais une autre forme de promotion, avec la tournée débutée il y a peu. Avez-vous réfléchi à mettre en scène Sexuality pour vos concerts ?
Avant, les concerts dépendaient de mon état du jour : si j’étais surexcité, je faisais un concert surexcité ; si j’étais malheureux, je faisais un concert très malheureux. Voilà. Avec Sexuality, j’ai compris quelque chose : la notion de plaisir. Et ma vision du concert n’est plus la même, maintenant : ce n’est plus moi qui m’amuse sur scène mais bien les gens qui se font plaisir. Je dois être le meilleur serviteur possible. D’ailleurs, j’aimerais bien que le public m’oublie vraiment : que je ne sois plus vraiment là, que je m’efface totalement derrière un nuage de fumée, et que ma musique soit beaucoup plus présente… Et puis, admettons que les gens n’aiment pas mon physique : je pourrais casser leur fantasme sexuel ! Alors que je voudrais qu’à mon concert, les gens s’embrassent, se caressent, soient émoustillés… Pour le premier concert de la tournée, à Londres, les critiques ont été dithyrambiques. J’étais vraiment étonné, parce qu’on a eu bon nombre de problèmes techniques, et au lieu de pouvoir me cacher parfaitement derrière des lasers et des écrans de fumée, j’ai dû me remettre en avant comme je le faisais avant. Mais pour les prochains concerts, la technique sera solide et je pourrai vraiment transmettre au public ce que j’ai envie de lui donner…
Travaillez-vous déjà à nouveaux projets ?
Non, je n’ai pas vraiment de piste. En fait, c’est très dur de trouver un sujet qui soit plus pertinent que l’origine du monde. Pour l’instant, je ne sais pas… Aujourd’hui, dans ma vie comme dans mon art, je compte beaucoup sur la science pour m’apporter des choses : la nouveauté, la nouvelle matière, je la trouverai peut-être dans la science et les découvertes scientifiques qui auront lieu… Sinon, en ce moment, je passe tous mes temps libres, parfois même mes nuits, à composer des B.O. : après Steak (La Petite Reine / 4 Mecs en Baskets / 4 Mecs à Lunettes, 2007) [le deuxième long métrage de Quentin Dupieux, alias Mr Oizo à la scène, ndlr] et leur série d’animation Moot-Moot (4 Mecs en Baskets / 4 Mecs à Lunettes / Franche Connection Animation, 2007) sur Canal+, je travaille à nouveau avec Éric et Ramzy sur Seuls Two (Les Productions du Trésor / M6 Films / TF1 Films / 4 Mecs à Lunettes / 4 Mecs en Baskets Production / Warner Bros), un film qu’ils ont réalisé et qui doit sortir en juin. Je fais aussi de la musique de film d’art contemporain pour un ami, Xavier Veilhan – j’ai d’ailleurs joué dans sa vidéo, Furtivo (Renaud Sabari / AIA productions / Xavier Veilhan, 2008)… Je fais de la pop, mais je pense que ça ne va pas à un Français de faire de la pop. Ni du pop-rock ni du reggae. Ce qui va à un Français, c’est de faire de la musique de film. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que c’est un genre musical noble. Alors je fais de la musique de film pour avoir cette espèce de noblesse d’un grand compositeur. C’est une question de style. C’est une culture qu’on a volée à une autre culture. Avec la pop, ça passe mal : on ne s’épanouit pas dans la pop française, parce qu’il n’y a pas d’aventure artistique. C’est un milieu un peu stérile. Mais, bon… J’en fais. Mais la classe, je vais la chercher dans la musique de film.
SEXUALITY, DE SÉBASTIEN TELLIER (RECORD MAKERS, 2008)
Mickaël Pagano, 2008
© PHOTOS : DR, LAURENT BOCHET, LAURENT BRANCOWITZ, MARIE DE CRÉCY