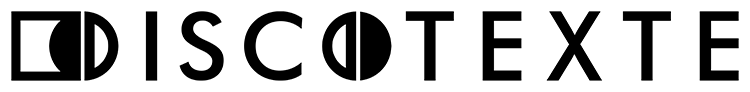JACQUES TATI
Portrait
![]()
Dans le siècle de Tati
![]()
Dans son éloge à propos de Playtime – le film a 30 ans cette année –, François Truffaut parle de Jacques Tati au nom de sa profession : « Il voit ce que l’on ne voit plus et il entend ce que l’on n’entend plus et le filme autrement que nous. »
Portrait d’un incomparable visionnaire.
Jacques Tatischeff est venu au monde de la comédie et du music-hall par le mime, au grand dam de son père et sans la reconnaissance du public. Troquant les numéros de ses maillots restés au vestiaire, où il faisait le clown devant ses partenaires au rugby dès l’adolescence, contre ceux qu’il joue lors d’un spectacle d’imitations, Impressions sportives, « Tati » naît véritablement sous les feux de la rampe en 1931. Il brûle les planches et les étapes, transformant ses essais comiques au cinéma les années suivantes : il écrit pour lui le rôle d’Oscar, champion de tennis (Jack Forrester, 1932), inscrit son nom d’acteur aux génériques de trois autres courts métrages – dont Soigne ton gauche de René Clément (1936) – avant de se mettre en scène dans Retour à la terre (1938). De cette première réalisation, l’on retient surtout la figure burlesque du facteur rural, laquelle Tati étudie et modèle encore dans L’École des facteurs (1947), sa dernière esquisse du personnage principal de Jour de fête (1949). Tati réussit l’exercice du long métrage, non sans peine : les distributeurs, qui ont toute autorité sur la diffusion du film, ne le trouvent pas drôle. Une seule projection improvisée permet pourtant à la salle comble, interdite devant tant d’humour, d’obéir à une envie – un besoin, aussi – : rire aux larmes.
Tati aime le comique de répétition et ses trois postiers en vélo consécutifs cèdent leur place au soleil des projecteurs à une personnalité qui, depuis Les vacances de M. Hulot (1953) jusqu’à Trafic (1971), tiendra le haut de l’affiche de chacun de ses films. « Un personnage d’une indépendance complète, d’un désintéressement absolu et dont l’étourderie, qui est son principal défaut, en fait, à notre époque fonctionnelle, un inadapté » selon Tati. C’est justement parce que M. Hulot est incapable de faire face aux conditions « normales » de la vie qu’il ne cesse de mettre en lumière, bien malgré lui, la dualité, voire la rivalité, du monde qui l’entoure : campagne/métropole, traditions/progrès, communion/communication…
Tati ne dérape jamais sur une peau de banal et se glisse avec ravissement dans celle d’un original. Dès la première apparition de son personnage fétiche, l’acteur-cinéaste voit le monde se fendre la pipe. Un triomphe international qui lui donne l’argent et donc le temps de tourner (et retourner) Mon oncle (et My Uncle, dans sa version anglaise, 1958), autre pellicule très applaudie tant par la grande famille du Septième Art que par les spectateurs, de plus en plus proches de l’auteur. Ces derniers, pourtant, ne saisissent pas nécessairement la réflexion de Tati : s’ils (d)énoncent la substitution d’un monde chaleureux, pittoresque et authentique à un microcosme froid, insipide et artificiel, ses films sont aussi l’annonce puis le reflet d’une France en devenir, ente 1950 et 1970. Comme si la prédilection s’était faite prédiction, Tati revient alors à ses débuts. En 1961, à l’Olympia, il reprend ses fidèles pantomimes, et projette un Jour de fête color(i)é au pochoir, habile démonstration d’une possible modernisation sans trahison ni altération.
Il faut presque dix ans à Tati pour produire Playtime (1967), un exposé détaillé sur les mutations urbanistiques et l’avènement du petit écran dans une culture de masse déjà omniprésente. Précédées par la tendance excessive du réalisateur (d’ailleurs surnommé « Tatillon » sur le plateau) à rechercher la perfection, les anecdotes de tournage – retards illimités (faute de moyens financiers et d’une météo favorable), démesure du décor (une « Tativille » futuriste édifiée su 15 000 m2) – nuisent à la réputation du film. Toutefois, quand bien même la critique multiplie les reproches à l’encontre d’un « mégalomaniaque », le nombre d’entrées totalisé par Playtime offre son plus grand succès populaire à la carrière de Tati. Un succès qui, provoquant la ruine de ses espérances, est bien plus difficile à encaisser qu’un échec. Car le coût final de son ambition – 15 millions de francs au lieu des 2,5 millions initialement prévus – met une hypothèque sur la maison de Tati, sa société en faillite et les droits des deux premiers Hulot aux enchères. Quatre ans plus tard, Trafic (1971) ne parvient pas à éponger les dettes du visionnaire…
L’ultime réalisation de Tati n’est envisageable qu’avec la collaboration technique et surtout budgétaire d’une télévision suédoise. À l’instar de cette exhibition du même nom que font les bateleurs avant la représentation, pour attirer leur assistance, le téléfilm Parade (1974) passe en revue différents numéros de cirque et de variétés. Un Monsieur Loyal a délogé M. Hulot, et Tati, dans un dernier pied-de-nez théâtral, comme une riposte vidéo finale à l’industrie cinématographique et ses contraintes économiques, rejoue ses saynètes d’antan devant un véritable public.
Jacques Tati, sans dialogues mais une bande son très écrite, a toujours parlé de la tragique disparition d’une philosophie (de vie) humaniste, voire du sentiment d’humanité. Il nous a quittés en 1982 tandis qu’il travaillait le scénario d’une œuvre au titre évocateur : Confusion.
Mickaël Pagano, 2008