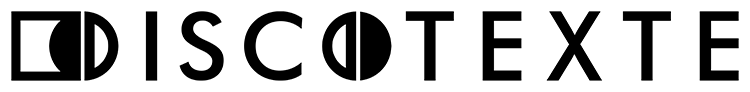Maagnétisme
![]()
LAAKE
« O »
LAAKE est une antithèse. Ce rapprochement de deux idées opposées qui prennent ainsi plus de relief, Raphaël Beau en a fait la définition et toute la perspective de son projet, la signification même de son album électro-orchestral.
Sorti et largement diffusé pendant la première interdiction de déplacement des Français, O est une lettre ouverte aux grands espaces comme au for intérieur, sa déclaration à la musique (avec majuscule) qu’on écoute en silence, fasciné.
L’artiste, qui s’était jadis jeté dans le maar – ce cratère rempli d’eau – en autodidacte volcanique et pianiste aimant, a peut-être signé là l’œuvre la plus attractive d’une année dont on cherche déjà à repousser le mauvais souvenir. Qui oserait dire le contraire ? LAAKE n’a pas son pareil.

Discotexte : Comme un avant-propos, j’aimerais te poser une question presque personnelle et déterminante pour le bon déroulement de cet entretien : puisque tu es désormais familier des interviews, penses-tu être élusif [du nom du premier projet solo de Raphaël Beau, en 2007, ndlr] au cours de celle-ci ?
Raphaël Beau : (sourire) Bien joué ! Je vois que tu t’es renseigné ! Eh bien, je ne peux pas te répondre tout de suite : ça dépendra évidemment de tes questions ! Mais, tu as réussi à écouter quelque chose ? Parce que les démos ne sont plus disponibles sur MySpace : elles ont disparu avec la refonte du site – ils ont fait le tri et supprimé énormément de sons… Donc, il n’y a aujourd’hui que moi, et peut-être quelques potes du lycée, je pense, qui ayons encore des morceaux d’Élusif…
Le temps a passé et tu défends ton premier album, O (SOMAA / Mercury Records, 2020), sorti en mars dernier, dix jours après le début du confinement, autre fait marquant de l’année. L’exercice de la promotion te semble-t-il, dans ce contexte, plus difficile ?
Effectivement, j’appréhendais un peu de sortir cet album en plein confinement. Mais je crois que ça nous a plutôt servi, en matière de promotion. Bien sûr, ça a été un peu plus compliqué de communiquer parce que certaines rédactions étaient « fermées », que beaucoup de journalistes ne travaillaient quasiment plus. Mais les gens étaient assez disponibles – ils étaient chez eux, sur Internet –, attentifs, et à ce moment-là très solidaires avec les artistes, les musiciens. Ils ont formé une sorte de communauté, un monde connecté et réceptif. Et il me semble qu’on a obtenu certaines choses qu’on n’aurait pas pu avoir en temps normal : je pense à tous ces live confinés, mis en place par les différents médias. Le premier que j’ai fait, pour Nova [radio FM française, ndlr], puis les quelques autres qui ont suivi n’auraient probablement pas eu lieu s’il n’y avait pas eu le confinement. Alors, ça a été plutôt bénéfique…
Sept mois après, qu’est devenu LAAKE ? Le projet se trouve-t-il grandi par ces circonstances particulières ?
Le confinement, très franchement, je l’ai accueilli avec philosophie. Cet album a constitué une charge de travail vraiment très, très importante : j’ai énormément bossé dessus, toute l’année passée, et j’ai même un peu tiré sur la corde les derniers mois. Le confinement est arrivé au bon moment. Le premier mois, c’était justement la sortie de l’album : j’ai donc continué de travailler à le faire connaître ; mais le deuxième mois a été salutaire et bénéfique pour moi : je n’ai absolument rien fait, je me suis reposé, enfin, et ça m’a fait du bien. Et puis, je l’ai bien pris parce que j’étais déjà habitué à ce mode de vie : j’ai toujours travaillé seul, de chez moi…

« Il y avait un piano chez mes parents, et j’ai très tôt improvisé parce que je ne savais pas lire les partitions. Ça ne m’intéressait pas. Le travail dans la musique me repoussait, il m’en dégoûtait plus qu’autre chose : moi, je voulais jouer pour m’amuser. »




Tu viens de le confier, O est le résultat d’une masse colossale de travail. Afin de comprendre les complications auxquelles tu t’es volontairement exposé pour relever tes propres défis sur la conception de cet album, peut-on revenir sur ton parcours d’autodidacte ?
J’ai commencé la musique assez tôt. Il y avait un piano chez mes parents, et je me suis mis très vite à improviser parce que, d’une part, je ne savais pas lire les partitions et que, d’autre part, ça ne m’intéressait absolument pas. J’ai bien essayé : j’ai fait un tout petit peu de solfège en primaire, mais ça rentrait par une oreille et ça ressortait immédiatement par l’autre. En fait, le travail dans la musique me repoussait, c’est-à-dire qu’il m’en dégoûtait plus qu’autre chose : moi, je voulais jouer pour m’amuser. Et puis, pendant mes années collège, j’ai fait du piano plus régulièrement : dès que je sortais des cours, je me mettais au clavier et je jouais pendant des heures… Depuis, je ne me suis plus jamais arrêté.

Tu sembles entretenir une relation particulière avec le piano : incarne-t-il à lui seul la définition de ta musique, instinctive et percussive ?
C’est avant tout un outil indispensable ; il est la pierre angulaire de ma façon de composer : je pense qu’au piano, on est capable d’écrire pour n’importe quel autre instrument. Moi, je pars toujours de là, en fait… J’ai l’impression qu’il me donne plus de possibilités qu’une guitare, par exemple, peut-être parce qu’on se sert de nos dix doigts et qu’il y a plus de notes disponibles d’un coup… J’aurai toujours, je crois, cet instrument à la base de mon travail de composition. Mais ce n’est pas pour autant qu’il y aura toujours du piano dans le projet LAAKE : à un moment, j’imagine que j’aurai envie d’aller sur un autre terrain. D’ailleurs, si je reprends le fil de mon histoire, au lycée, et après pendant mes études supérieures, j’ai aussi monté des petits groupes de rock où j’étais plus souvent à la guitare, et surtout des projets solos qui me permettaient d’entremêler mes goûts, mes influences – la musique électronique, le metal, la guitare classique –, mais en y associant presque toujours le piano. C’était un peu fouillis, mais je tenais déjà les bases de ce que je voulais faire : mélanger des instruments les uns avec les autres, et ne pas m’inscrire dans une case. Cela n’a jamais été une envie assumée d’être en marge – je n’ai d’ailleurs pas l’impression d’être un vilain petit canard –, mais plutôt un besoin de réaliser ce qui me passait par la tête sans le conceptualiser forcément, dans le seul but de voir ce que ça allait donner. J’essaye toujours de garder le plus de spontanéité possible dans la composition : c’est pourquoi certains morceaux de l’album ont été écrits en moins d’un jour voire une après-midi ; le plus dur étant, à chaque fois, dans ce processus de création, de se remettre sur un morceau qui a donc été créé en un laps de temps très court et de le retravailler indéfiniment pour qu’il soit le meilleur possible.
En 2014, quand tout commence vraiment pour LAAKE, ton appétence pour la diversité musicale est encore palpable puisque tu es encore partie intégrante de CANCR, un duo piano / batterie avec Ludovic Verwaerde, et SPINAL (d’abord appelé SPINALCHORD), un groupe de rock avec Clément Martin et Aurélien Papa Techera.
Tout à fait. Je menais encore trois projets en même temps.
Cette multitude de projets était-elle une nécessité pour nourrir le projet LAAKE en devenir ?
Quelques-unes de mes compositions ont demandé et mérité de créer un projet en particulier pour pouvoir exister. J’avais déjà SPINAL, mon groupe de rock, quand j’ai monté CANCR : mais j’avais toujours voulu monter cette combinaison piano / batterie, alors – bon, malheureusement, on n’a fait qu’un seul concert, parce que mon pote est parti vivre à Lille… J’avais besoin de faire plusieurs choses en même temps.
Mais l’idée commune, c’était faire de la musique, tout simplement. C’est mon moyen d’expression, ma façon d’extérioriser, de me « soulager » de certaines émotions – parce qu’autant je peux être quelqu’un d’assez extraverti dans la vie de tous les jours, autant, d’un point de vue émotionnel, j’ai tendance à garder pas mal de choses en moi… Et même si je ne le pense pas comme ça, je m’en rends compte : je me décharge de beaucoup d’émotions négatives quand je crée… La musique, c’est aussi une manière de m’occuper, de penser à autre chose : elle peut être salvatrice. J’avais une ambition pour chacun de ces projets : je m’y suis investi à niveau égal. Après, par la force des choses, certains se sont arrêtés et d’autres ont perduré. Mais à l’époque, LAAKE n’avait pas encore pris autant d’importance que maintenant dans ma vie…
D’ailleurs, tu composais sous un autre nom : I’m Falling Down…
Tout à fait. Tu as trouvé des sons, là-dessus ? C’est No plans, le premier morceau que j’ai composé pour LAAKE, qui a fait le pont, la transition, entre les deux projets : je l’ai juste partagé sur ma page I’m Falling Down, histoire de dire : « Maintenant, c’est LAAKE. » Mélanger le piano et l’électro, c’est un concept que j’avais depuis un moment en tête – l’idée, même, de jouer un jour avec un orchestre, a germé en moi pendant une dizaine d’années : c’est vraiment un truc que j’ai en moi depuis longtemps ! J’ai eu la patience d’attendre avant de me lancer dans ce projet… Et j’ai bien fait : il me fallait acquérir plus d’expérience dans la musique ; et dégager plus de temps, donc quitter mon travail [de graphiste et directeur artistique freelance, ndlr] afin de me consacrer au projet à 100 %.
Un projet qui ne cesse de grandir et de se renouveler depuis sa création jusqu’à la parution de O.
Je ne suis pas dans l’envie de me renouveler forcément – je n’aime pas ce terme –, mais plutôt d’évoluer, en fait. C’est clair, je n’aime pas faire toujours la même chose. J’ai du mal à me contenter de ce que j’ai à un moment donné : c’est-à-dire qu’il me faut toujours un peu plus, et j’ai besoin, pour travailler ma créativité, aussi, de faire des choses différentes, de ne pas me reposer sur des acquis. C’est important pour moi d’aller dans des directions que je ne connais pas et, d’une certaine manière, de me mettre en danger.
L’année 2016 n’est peut-être pas celle de tous les dangers, néanmoins, après ton premier EP, 69 (2015), et avant le deuxième, PIAANO (2017), elle est marquée par deux événements exigeants : ta participation au Beethoven Remix, concours initié par la Philharmonie de Paris alors que tu « fuis » la musique classique…
Ah oui, c’est vrai, tu as raison : j’ai fait ça ! Et je n’ai pas gagné d’ailleurs – je crois que je n’étais même pas dans les trois premiers ! L’idée, c’était justement de déconstruire cette œuvre-là [le 2e mouvement, « Allegretto », de la Symphonie n°7 en la majeur op. 92 (1811-1812), ndlr] – un super morceau de [Ludwig van] Beethoven, quand même : ce n’était pas n’importe quoi ! – et l’exercice m’a paru intéressant, parce que ce n’est plus seulement ma musique, et par conséquent, je ne compose pas de la même façon. C’est-à-dire qu’il y a quelque chose de décomplexé à utiliser une matière qui n’est pas la mienne. Je me souviens, j’étais alors en plein tournage d’un clip pour un autre artiste, et j’ai dû travailler ce morceau à moitié dans le train… Mais j’étais enchanté d’emmener le grand Beethoven vers quelque chose de différent, content de faire son remix – bien plus encore que de participer au concours, finalement.
La même année, ton entrée dans la playlist si sélective du Piano Day [festival créé en 2015 par le pianiste, compositeur et producteur allemand Nils Frahm, qui se tient chaque année le 88e jour, en référence au nombre de touches composant un clavier de piano, ndlr], elle, n’est pas passée inaperçue.
Seulement parce que les médias, les journalistes, ont toujours besoin de se raccrocher, de nous rapprocher à un autre artiste, plus connu. Nils Frahm, c’est quelqu’un d’important dans ce milieu, et les gens avaient besoin d’une référence, alors on m’a collé cette étiquette, laquelle n’était pas désagréable. Pourtant, bien que je respecte énormément son travail, je ne me sens pas particulièrement proche de lui, ni fan ni influencé. Au bout d’un moment, j’en ai eu un peu marre qu’on me compare à lui, qu’on trouve des similitudes dans notre pratique : ok, on fait tous les deux du piano assez rythmique, répétitif, mais ce n’est quand même pas la même musique ! Ni tout à fait la même démarche – Nils Frahm n’a aucun clip vidéo, par exemple – et encore moins la même façon de travailler – c’est un puriste, un vrai, qui ne jure que par l’analogique tandis que je ne suis quasiment que sur ordinateur ! Mais bon, je ne me suis jamais plaint : ça m’a plutôt servi, au final, et me retrouver dans la playlist de 2016 m’a pas mal aidé, c’est clair. Ça a été important… Et puis, depuis la sortie de O, on ne me compare plus du tout à lui…





Parlons justement de la réalisation de O : nous l’avons évoqué précédemment, tu as cherché à prendre des risques, à te mesurer à des difficultés que tu n’avais pas rencontrées avec tes deux EP.
Les EP, je les ai enregistrés tous les deux dans ma chambre en peu de temps : ce sont des improvisations limite remises en forme, quoi ! Enfin, disons qu’ils ne m’ont pas donné autant de travail que O. En fait, j’ai tout de suite composé cet album en me disant, dès le début, que j’allais faire quelque chose d’orchestral : comme d’habitude, j’ai commencé avec un piano, chez moi, dans mon petit studio, et puis, grâce à l’ordinateur et les plugins, les cordes et les cuivres ont vite suivi. J’ai écrit un morceau et je me suis dit : « Bon, maintenant, il faut que j’en fasse dix autres » ; et c’est venu naturellement. Mais avant l’étape finale, pour laquelle on est passés en studio pour réenregistrer tous les instruments, il y a eu un long travail d’arrangements des cordes, avec la découverte et l’apprentissage des différentes tessitures des instruments mais aussi de l’écriture de partitions – que je ne prétends toujours pas connaître, ou du moins suffisamment pour que ce soit compréhensible pour un musicien classique.
Pourquoi ne pas avoir choisi la facilité : profiter de toutes les possibilités qu’offre la machine, avec ses bibliothèques d’instruments, à l’instar du single FAAKE (Tølva Records, 2016), qui était déjà très orchestré ?
Ce morceau est différent des autres, effectivement. Mais ça me paraissait évident, en fait. J’aime les instruments classiques, et sur scène, j’utilise de plus en plus souvent un « vrai » piano ; j’aime aussi la musique électronique, synthétique, qui est à la base de mes morceaux et qu’il fallait, d’après moi, mettre en opposition avec quelque chose de, non pas « organique » – parce que tout le monde utilise ce terme – mais plus traditionnel. Je voulais mélanger ces deux techniques : l’acoustique et l’électronique.
En définitive, combien de temps la réalisation de cet album aura-t-elle nécessité ?
Pas tant que ça, finalement : deux ans, environ, sans que je travaille tous les jours dessus. Les morceaux ont été composés assez rapidement, en quelques mois, en fait, et il n’y a eu que trois semaines d’enregistrement en tout ; entretemps, l’écriture des partitions, elle, s’est étalée sur plusieurs mois – je ne saurais pas dire combien exactement, mais au moins six –, et dans la foulée, il y a eu toutes les séances de répétitions avec les musiciens… Oui, globalement, ça m’a pris deux ans pour écrire et finaliser O.
Autre défi, conséquence directe de cette volonté à composer pour un orchestre : le live. Comment s’organise la tournée ? Et surtout, avec deux quatuors sur scène, parviens-tu encore à laisser une place à l’improvisation, à favoriser l’idée de liberté à laquelle tu tiens tant ?
Oui, tu as remarqué comme il y a toujours une part de défi dans ce que je fais ? J’ai toujours travaillé avec plusieurs formules : quand j’ai tourné pour la sortie de PIAANO, j’étais soit tout seul sur scène avec un piano numérique et un synthé, sinon avec un piano à queue, soit en duo avec Juliette [Serrad, ndlr], ma violoncelliste. Pour O, j’ai aussi imaginé trois formules différentes, mais je suis toujours accompagné, dorénavant : ou par un violoncelle pour un duo, ou par un quatuor à cordes, ou par l’orchestre au complet. Mais le live avec tout ou partie d’un orchestre, c’est vraiment une approche complètement différente du concert, notamment parce que tout est écrit et que les partitions se trouvent sur scène. Évidemment, ça laisse moins de place à l’improvisation. Mais c’est quelque chose que je vais essayer de ramener, au fur et à mesure de la tournée. Moi, je continue d’improviser des passages entre les morceaux ; et c’est un exercice, un jeu qu’on a d’ailleurs toujours connu, avec Juliette. Mais j’aimerais pouvoir aussi improviser avec les autres instrumentistes qui m’accompagnent. On a commencé à mettre ça en place, un peu : lors de notre dernier concert, je me suis retourné, j’ai regardé mon trompettiste, il a compris immédiatement ce que j’attendais de lui et on s’est mis à jouer ensemble. C’est important pour moi – je l’ai déjà dit : je n’aime pas faire toujours la même chose –, et je pense que ça l’est tout autant pour les musiciens : c’est une manière, déjà, de leur donner, sur scène, l’intérêt qu’ils méritent, mais aussi de les faire sortir des sentiers battus, qu’ils se mettent en danger. Alors, tout ne sera pas parfait, il y aura peut-être des fausses notes ou des moments d’hésitation, mais il me semble que plus on fait de l’improvisation, plus on est à l’aise sur scène.
Après tout, vous n’êtes pas des machines…
Voilà ! Et c’est ce qu’il faut montrer aussi… Parfois, je regrette presque de leur faire jouer des partitions et qu’ils ne puissent pas s’exprimer comme ils le pourraient ou le voudraient. Moi, ça m’est totalement étranger ! Après, certains commencent à les connaître par cœur, mais comme les musiciens ne sont jamais tous disponibles à la même date, je dois trouver des remplaçants, et je suis donc obligé d’avoir des partitions sur les pupitres…


« Improviser en concert, c’est important pour moi, et je pense que ça l’est tout autant pour les musiciens qui m’accompagnent : c’est une manière
de leur donner, sur scène, l’intérêt qu’ils méritent, mais aussi de les faire sortir des sentiers battus, qu’ils se mettent en danger. »
As-tu le sentiment de faire la liaison entre deux « cultures », entre une musique populaire et une autre dite savante, à l’instar du compositeur de musique contemporaine américain Philip Glass ou du trio électro-classique berlinois Brandt Brauer Frick, que tu affectionnes particulièrement ?
Oui, j’ai l’impression de faire le pont entre les deux. En tout cas, je m’en rends compte en voyant qui vient à mes concerts : il y a autant de jeunes issus du milieu de la fête que de personnes plus âgées, voire même très âgées, et peu habituées à cette musique – je me souviens d’un vieux couple : « Vous savez, c’était notre premier concert électro ! » C’est marrant, ce brassage, cette mixité… Et ça m’intéresse de rapprocher des générations. Attention, l’idée n’est pas de plaire à tout le monde mais de toucher le plus grand nombre : c’est important pour moi, même si je ne me pose pas ce genre de question, que je ne prends pas du tout en compte le fait de « séduire » telle ou telle tranche d’âge quand je crée, quand je compose. Du coup, découvrir le soir d’un live, souvent après le spectacle, que des gens de tous âges sont venus me voir et ont apprécié ma musique, c’est vraiment très agréable. C’est gratifiant aussi : c’est une récompense.



« J’ai un contrôle sur tout ce qui est autour du projet mais pas sur son essence : je ne m’oblige jamais à faire de la musique. Ce doit être un pur moment de liberté. Parce qu’à trop travailler la musique, on perd sa créativité et on se lasse très vite. »
Cela honore à juste titre ton travail… J’aimerais revenir sur l’insatiable énergie et le dévorant besoin de bravade qui t’ont (pré)occupé pendant la réalisation de ce premier album : la performance est-elle le corollaire d’une envie de tout contrôler ?
C’est un problème… Non, ce n’est pas un « problème » à proprement parler : il s’agit d’un défaut, et peut-être aussi d’une qualité. Oui, j’aime bien tout contrôler, ou, plus exactement, j’aime bien faire les choses par moi-même – et j’ai franchement du mal à déléguer. En fait, j’ai une vision assez précise de ce que je veux faire. Même si j’ai plusieurs choses à faire à la fois, d’ailleurs ! J’en ai parlé tout à l’heure : j’ai clairement du mal à me concentrer sur une chose en particulier, alors je fais toujours plein de trucs en même temps – c’est mon côté hyperactif ! Mais je le vis plutôt bien. C’est juste que je manque de temps, parfois – souvent, même !
Le contrôle jusqu’à la perfection ?
Je n’aime pas ce mot. Ce qui m’importe avant tout, c’est d’être satisfait. Justement, non, je n’ai pas envie que tout soit parfait, sinon ça ne correspondrait pas à mon modèle de pensée. En fait, j’ai bien le contrôle sur tout ce qui est autour du projet – c’est-à-dire les arrangements, l’enregistrement, le mixage, ou encore l’image, etc. – mais pas sur son essence : quand je fais de la musique, c’est un pur moment de liberté. Je ne m’oblige jamais à faire de la musique ; je ne m’impose jamais des temps de composition. C’est même devenu un leitmotiv. Parce qu’à trop travailler la musique, on perd sa créativité et on finit par se lasser, très vite, je pense.
Puisque c’est un rêve de longue date qui se réalise enfin, O marque déjà un aboutissement dans ta « jeune » carrière de musicien. Le choix de cette lettre circulaire pour titre d’album figure-t-elle d’ailleurs que tu as bouclé une boucle ?
C’est intéressant de penser à ça… En vérité, ce O est celui d’« ORCHESTRAA », parce qu’au départ, j’avais dans l’idée d’appeler cet album ORCHESTRAA – ce titre apparaît quand même sur la pochette –, comme une suite logique ou une contrepartie à PIAANO, mon deuxième EP. Mais entretemps un artiste – euh, je ne me souviens pas du tout de son nom… un DJ… [Worakls, ndlr] – avait sorti un album électro-orchestral intitulé Orchestra (Hungry Music, 2019)… Bref, j’ai gardé le O : une lettre qui pourrait être un chiffre, avec ce côté rond, cette notion d’infini, de boucle, effectivement. Après, c’était aussi l’année de mes 30 ans : donc le rond du zéro. En fait, le cercle a toujours été assez important pour moi : c’est une forme que j’ai beaucoup utilisée dans mes visuels, avec laquelle j’entretiens des liens depuis longtemps.


Aujourd’hui, tu es totalement investi dans ce seul projet, au point d’avoir mis de côté ta carrière de graphiste, comme tu l’as évoqué précédemment. Pour autant, tu conçois tes pochettes et réalises la majorité de tes clips. Là encore, est-ce compliqué, pour toi, de laisser la main à quelqu’un d’autre ?
L’image – la photo, la vidéo – est devenue extrêmement importante, primordiale, aujourd’hui. Et la musique que je fais s’y prête tellement que cette dimension-là fait clairement partie intégrante du projet ! Et c’est effectivement sur l’aspect visuel du projet que j’ai le plus de mal à déléguer : après tout, c’est mon métier – enfin, ça l’a été…
A-t-il été difficile, donc, de confier la réalisation du clip de RUN, premier single de l’album, à Vincent de la Rue ?
Oui, d’une certaine manière, ça m’a été relativement pénible. Disons que j’aime garder la main sur tout… On a quand même fait des choses ensemble, en termes de conception ; mais je n’ai pas assisté au tournage – heureusement, d’ailleurs, parce que j’étais alors en plein enregistrement. Et il y a eu quelques discussions un peu tendues parce que chacun avait son point de vue – et j’avais vraiment des idées précises en tête –, parce que j’étais très pointilleux sur des trucs techniques – dans le montage ou l’étalonnage, par exemple. Je pense que ça a été dur pour lui comme pour moi. Mais finalement, je suis très content de ce clip. Il a très bien travaillé, Vincent…
Le milieu du cinéma ne s’est-il pas encore adressé à toi ?
Non, et j’attends ça avec beaucoup d’impatience ! C’est un objectif que j’ai depuis longtemps aussi : faire la musique d’un long métrage…
Et pourtant, tu as souvent confié que, tel un auditeur, c’est bien la musique qui t’inspire des images. Comment travaillerais-tu s’il fallait cette fois te mettre au service d’un film ?
C’est précisément ce qui m’intéresse, parce que je dois laisser mon ego de côté. Comme pour un remix, il s’agit de s’oublier, d’accepter d’être emmené dans un ailleurs qui ne nous ressemble pas forcément afin de créer pour un autre. Et ce genre d’exercice me permet parfois de me délester d’un poids, de cette pression que l’on a lorsque l’on compose pour soi.
Et c’est un paradoxe, puisque malgré une tendance à l’absolutisme, tu n’es pas avare de participations diverses – citons tes remixes pour Ibeyi (River, 2015), Sibéri (Unmatching Us, 2015), Vimala (See Through, 2017), et tes featurings sur les albums de Contrefaçon (Acmé sur Mydriaze, 2019) et TAUR (We Feel sur 40, 2020). Est-ce indispensable de se confronter ou de s’ouvrir à d’autres artistes ?
Toutes les personnes que tu as citées sont des ami(e)s à moi : on s’est rencontrés par le biais de la musique ou de relations communes, et on gravite un peu tous dans la même sphère. Chaque fois, l’idée de faire un morceau ensemble a germé grâce à notre amitié, au fait d’être soudés entre musiciens. Quand on fait un projet, on est généralement tout seul. Alors, collaborer avec d’autres artistes, ce n’est pas tant se mettre en danger, cette fois, mais plutôt aller vers quelque chose de différent et composer pour un ensemble. En cela, je pense que c’est important.
Tu as d’ailleurs permis à deux femmes de « s’emparer » de ton projet. Il y a d’abord celle que tu as invitée à poser sa voix sur MIND, la chanteuse et productrice Tallisker [Éléonore Mélisande, de son vrai nom, ndlr], que l’on pourrait présenter comme ton alter ego…
Ouais, carrément : on a plein de points communs musicaux, elle et moi ! Et c’est une amie, aussi… En fait, je l’avais déjà invitée lors d’un concert à La Marbrerie [dans le cadre du Piano Day 2017, ndlr] : on avait repris ensemble l’un de ses morceaux [Schist, tiré de l’EP Heliotrop (YumYum Records, 2017), ndlr]. Il y a une très forte complicité entre nous. Et ça me paraissait évident qu’on fasse un jour un duo ensemble, alors j’ai voulu qu’elle participe de cette façon à mon album. D’ailleurs, elle aussi, normalement, devrait m’inviter sur le sien.
La seconde appelée, c’est la violoncelliste et multi-instrumentiste Juliette Serrad, devenue ton binôme…
Juliette, c’est la première personne avec qui j’ai travaillé sur ce projet. Il y a eu un moment où je n’ai plus voulu être tout seul sur scène : j’ai cherché des musiciens pour m’accompagner, et je l’ai rencontrée par le biais d’amis en commun ; on a fait une répétition, et le courant est tout de suite passé entre nous – si bien qu’on a improvisé ensemble pendant des heures ! Depuis, elle m’a toujours suivi : ça fait cinq ans, maintenant, qu’on travaille ensemble. Juliette est super importante pour moi : c’est un appui, et bien plus encore… Elle m’a aussi permis de rencontrer une bonne partie des musiciens présents sur l’album ; et c’est à elle que j’ai montré mes partitions pour la première fois, c’est elle aussi que j’ai écoutée quand, lors des premières répètes avec les musiciens, elle a pointé du doigt certains trucs et m’a conseillé pour bien les refaire…
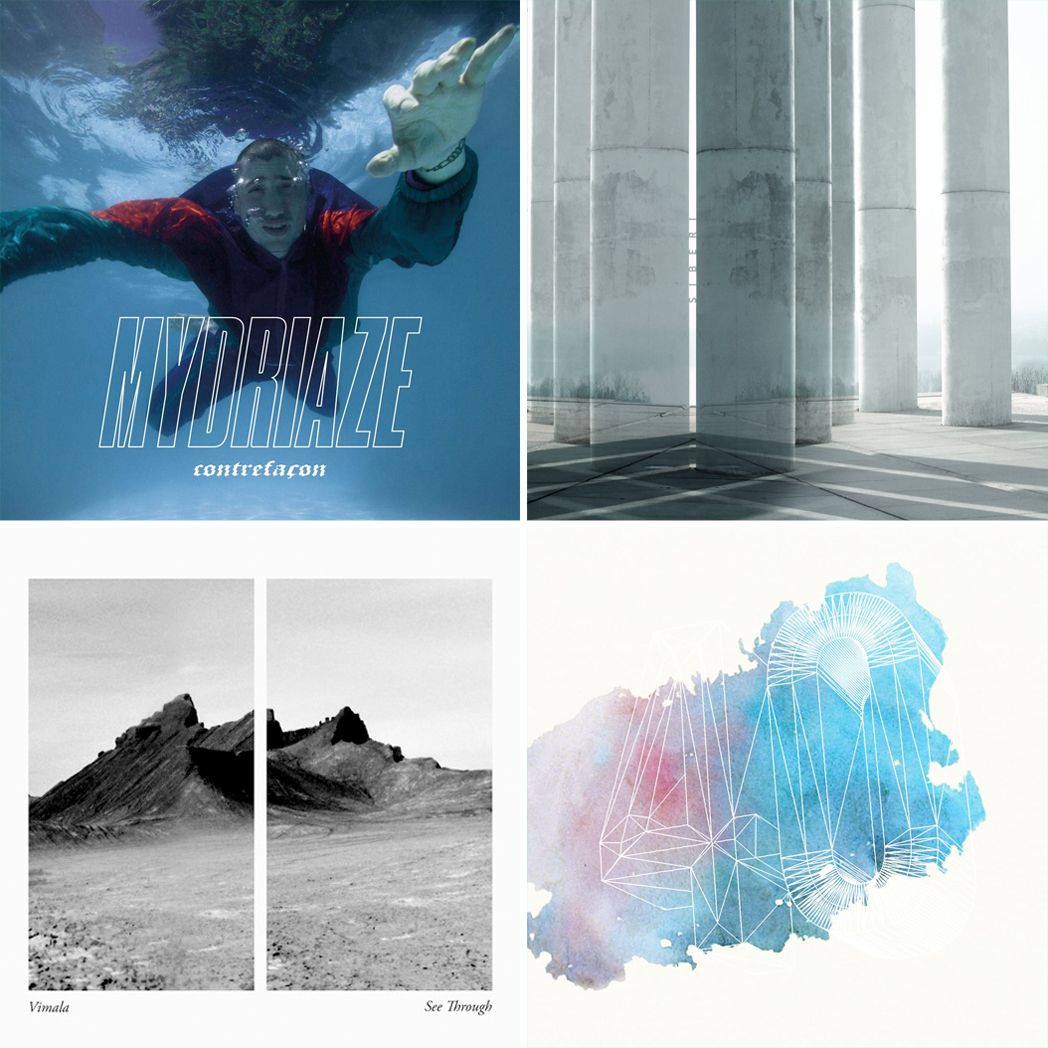


Les deux font la paire, d’après une vieille expression. Cependant, le projet LAAKE évoquerait davantage la dualité : avec la machine versus les instruments acoustiques, avec des contrastes marqués dans ta musique comme dans les sentiments qu’elle évoque, avec cette opposition du noir et du jaune dans tes visuels mais aussi de la roche et de l’eau dans la plupart de tes clips…
Exactement. Je crois que ça correspond à ma personnalité, en fait : je suis à la fois quelqu’un de très calme et d’hyperactif, capable de « bouillonner » énormément. Tout comme la musique que je fais, que j’ai toujours fait – mélancolique, ou sombre, avec des élans de lumière dans certains morceaux –, sans qu’il y ait une connexion à faire entre elle et mon état psychologique lorsque je compose : je peux être très heureux à un moment donné et pourtant écrire une musique très triste… Oui, je peux être tout et son contraire.


Ces deux faces antinomiques se révèlent-elles à travers cette intimité dévoilée à demi-mots – avec des titres (NOVEMBER, 1989) qui parlent de toi et des textes qui touchent autant à l’indicible qu’à l’universel (l’amour, la séparation, la solitude, la relation père/fils) – et pourtant dissimulée derrière une voix transformée, presque impersonnelle ?
Contrairement à ce qu’on pense, ma voix n’est quasiment pas modifiée : il s’agit de ma voix la plus grave, caverneuse, gutturale. Il y a bien des effets dessus – des compresseurs, des reverbs –, mais ce ne sont pas des effets de déformation de voix particulière – je ne me suis pas servi d’autotune, ni de corrections de hauteurs dans le grave. En revanche, j’ai joué des superpositions de voix : sur NOVEMBER, par exemple, il y en a dix les unes sur les autres. Alors, oui, effectivement, on pourrait croire que je me dissimule un peu… C’est seulement que la voix n’est pas centrale dans ce projet. Je ne me revendique pas chanteur. Sur O, j’avais dans l’idée d’avoir un témoin vocal, quelque chose de raconté. Parce que ce n’est même pas vraiment chanté, en fait : souvent, c’est un peu monocorde, avec ce petit côté nostalgique. J’ai volontairement choisi cette voix plutôt linéaire : elle se prête mieux qu’une autre, plus mélodique, à la musique, dans laquelle il y a déjà beaucoup de thèmes accumulés.
On a l’impression d’un poème déclamé…
C’est clairement ça ! MIND, à la base, c’est un poème. Avec Tallisker, on s’est posé beaucoup de questions, on a longtemps cherché nos voix, testé plein de mélodies et de paroles en anglais, d’abord, mais en vain. « Ok, on va tester un truc. » Elle est venue chez moi et j’ai griffonné trois strophes – trois conneries – sur le papier, en français, qu’on a réussi à « chanter ». Ce n’était évidemment pas du tout les mots qui convenaient, mais on s’était enfin rendu compte qu’une voix plutôt monocorde collait beaucoup mieux à la musique. J’ai ensuite écrit le texte d’une traite, en une après-midi. Le morceau s’appelait déjà MIND, et ce titre a influencé son propos : la perception d’un monde qui s’écroule, une vision presque post-apocalyptique – très présente aussi, d’une autre manière, dans la musique –, dans laquelle j’avais envie de cacher des fleurs – chaque couplet recèle l’une d’elles – ; et je pense vraiment que son sujet correspond pas mal avec l’identité globale de l’album.


Mais ce premier album parle avant tout de toi, non ?
O est sorti l’année de mes 30 ans, et j’ai voulu l’envisager comme un témoin du moi à cet âge-là pour le moi de plus tard, comme un souvenir de moi que je me suis laissé pour le futur – « Tiens, qu’est-ce que je faisais pour mes 30 ans ? Ah ben, oui, je sortais mon premier album ! » Alors il est plein de références, de petits clins d’œil personnels : on y trouve par exemple le titre NOVEMBER et onze morceaux au total parce que je suis né en novembre, onzième mois de l’année ; il y a aussi 1989, l’année de ma naissance ; et si on fait certains calculs, si on soustrait la durée de certaines chansons, on obtient un chiffre qui n’est autre que celui du jour de naissance… Mais c’est une intention dont je ne me suis pas servi pour faire la promotion de l’album : tout ça, je ne l’ai fait que pour moi, et ça reste d’ailleurs du domaine de l’intime. J’aime tout aussi bien que chacun fasse sa propre interprétation de mes chansons : je ne veux pas en donner qu’une seule lecture – c’est malheureusement déjà trop souvent le cas pour certains albums « concepts »…
On a précédemment évoqué la dualité. Le principe du double, de la reproduction, semble tout aussi pertinent dans le projet LAAKE : avec le doublon de la lettre A que l’on retrouve dans plusieurs titres, avec la répétition des boucles mélodiques et rythmiques propre à l’électro, avec la (presque) reprise de tes morceaux – RUN serait-il une autre version ou une citation d’INTROSPECTIVE ?
Les deux A, c’était avant tout un jeu typographique : je voulais évidemment évoquer une dualité – entre l’électronique et l’acoustique, l’obscurité et la lumière, le noir et le blanc, etc. J’ai appris après coup que « laake » signifiait « médicament » en finlandais, et cette notion de remède par la musique m’a parlé et m’a plu : alors j’ai gardé le nom et l’orthographe. Quant à ma musique, je pense qu’il y a effectivement dans chacun de mes disques un morceau où l’on trouve une même mélodie qui se répète indéfiniment. Et même si je ne me suis pas basé sur l’un pour créer l’autre, c’est bien le point commun entre INTROSPECTIVE et RUN : dans INTROSPECTIVE, le thème est vraiment quasiment toujours le même, tandis que dans RUN, je découpe, je fractionne quand même pas mal la mélodie, tout en gardant cette idée de cycle infernal. Au fil du temps, je me suis rendu compte que les morceaux qui ont le mieux fonctionné auprès du public sont, justement, souvent ceux qui ont une même mélodie tout du long. Bon… C’est un exercice que j’aime bien, mais je n’ai pas envie d’utiliser cette recette tout le temps : non seulement ça pourrait me gaver très vite, mais je préfère généralement casser les rythmiques – comme dans l’album, où il y a beaucoup de ruptures de tempo, beaucoup de passages différents dans les morceaux.


« Je me suis lassé de la machine, de l’électro : mon nouvel album sera plus jazz ou plus rock, plus live, et donnera plus de place à l’improvisation. Je ne vais pas refaire un album orchestral précisément parce que j’avais déjà fait celui-ci pour changer, me réinventer. »

On retrouve également la similitude d’une boucle mélodique en rapprochant RUN, qui ouvre l’album, de LIGHTS, qui le clôt.
Oui, c’est vrai, elles se font écho. Avec RUN, il y a vraiment quelque chose de l’ordre de l’urgence ; avec LIGHTS, quelque chose d’un peu plus placide mais qui se termine un peu dans une même urgence – parce que, comme je viens de le dire, j’aime bien installer un climat et finalement le briser. La composition de LIGHTS correspond parfaitement à mon envie de fermer l’album, et de l’ouvrir tout à la fois.
Quid des ressemblances entre les clips, cette fois, de RUN et de 69 ?
Alors, oui, il y a des similitudes, mais ce n’est vraiment pas volontaire. Le clip de 69 est le tout premier que j’ai réalisé : je ne savais absolument pas comment m’y prendre, à l’époque, et je n’avais en tête que le scénario de « quelqu’un qui court vers un point dont on ne sait ni ne saura rien ». Pour RUN, du fait de son titre, c’était une évidence de faire un clip avec un personnage qui court aussi ; mais ce n’est pas tout à fait la même histoire… Après, il s’avère que les deux vidéos ont été tournées en Bretagne, donc on peut facilement leur trouver des similitudes – forcément. D’ailleurs, tant que je parle de paysage, on peut aussi trouver des correspondances entre les clips de RUN et d’INTROSPECTIVE, puisqu’il y a ce rapport à la nature assez fort dans les deux.
Justement, comment éviter les redites ? N’est-ce pas une hantise dans un processus de création ?
Non, ça ne fait pas peur. Mais si j’ai fait cet album orchestral, c’est précisément pour changer. C’est tout l’enjeu, maintenant : c’est-à-dire se réinventer, comme tu le disais tout à l’heure, et aller vers quelque chose de différent – même dans l’image : je ne vais pas réaliser toute ma vie des clips avec un mec qui court le long des falaises !
As-tu déjà réfléchi aux futurs projets qui te permettront de ne pas tourner en rond ?
Étonnamment, mon prochain projet ne correspond presque en rien avec tout ce que je viens de te dire : depuis longtemps, j’ai envie de faire un mini album de transition – un petit EP – assez minimaliste, avec uniquement des morceaux autour du piano, solo, sans électro. Mais pour cela, il y a d’abord un gros travail de tri à faire dans les milliers de compositions enregistrées sur mon téléphone depuis 2012 : j’ai déjà commencé, mais j’ai sélectionné cinquante morceaux rien que pour l’année 2013 ! C’est énorme ! Je ne sais pas comment je vais m’y prendre… En attendant, je travaille sur la suite, le deuxième album, dans lequel je voudrais intégrer des éléments percussifs – une batterie, parce que j’ai vraiment envie de rejouer avec un batteur, et une basse – et un ou deux instruments traditionnels comme le violoncelle et la trompette ; je voudrais aussi retourner vers quelque chose de plus live, donner plus de place à l’improvisation. Je ne peux pas te dire à quoi ça ressemblera : pour l’instant, je n’ai qu’un seul morceau… Mais je me suis un peu lassé de la machine, de l’électro dure avec un kick sur tous les temps, alors, même s’il y aura très probablement des synthés, je pense que je vais orienter ce nouvel album vers quelque chose de plus jazz ou plus rock. Voilà, je vais prendre une autre direction : je ne vais pas refaire un album orchestral. Ce n’est pas du tout l’idée, sauf si on me demande de composer pour une création particulière. D’ailleurs, je travaille aussi, en ce moment, sur la musique d’un spectacle de danse contemporaine qui verra le jour, a priori, en 2021 [In extremis, de Frédéric Cellé, avec sa compagnie Le grand jeté !, ndlr] : demain, je vais à Chaillot [Théâtre National de la Danse (Paris), ndlr] pour assister aux toutes premières répétitions. Je suis très impatient.


Tout cela en parallèle d’une tournée qui a repris fin août, qui ne cesse de grandir avec une nouvelle mise en scène et un nombre de dates croissant…
Bien sûr ! Maintenant, sur la tournée, j’ai un ingé’ lumières qui a fait toute une création autour du live, millimétrée sur la musique. On y a réfléchi ensemble, je lui ai soumis quelques pistes, et puis il y a travaillé pendant trois mois – pendant le confinement… (Son portable vibre) Tiens, c’est marrant ! C’est lui qui m’appelle, là ! (Il répond mais coupe court à la conversation) On en était où ? La tournée ? Oui, je suis content : la dernière date est prévue en août prochain ! Et, pour l’instant, elle ne s’arrête pas… [Depuis, un nouveau confinement est entré en vigueur le 30 octobre en France, entraînant la fermeture des lieux culturels au moins jusqu’au 7 janvier 2021 et donc l’annulation d’une quinzaine de concerts de LAAKE prévus sur cette période, ndlr]
O, DE LAAKE (SOMAA / MERCURY RECORDS, 2020)
Mickaël Pagano, 2020
© PHOTOS : DR, ARTHUR, RAPHAËL BEAU, ALEXIS CABRIOL, ISABELLE CHAPUIS, SÉBASTIEN DARDARE, LEITER, GILLES MILLE,
ROD MAURICE, PAUL MOREL, HANA OFANGEL, MAX PAROVSKY, PAUME, LAURENT PHILIPPE, GWÉNAËL SÉRIEYS, LAURIE TEDONE